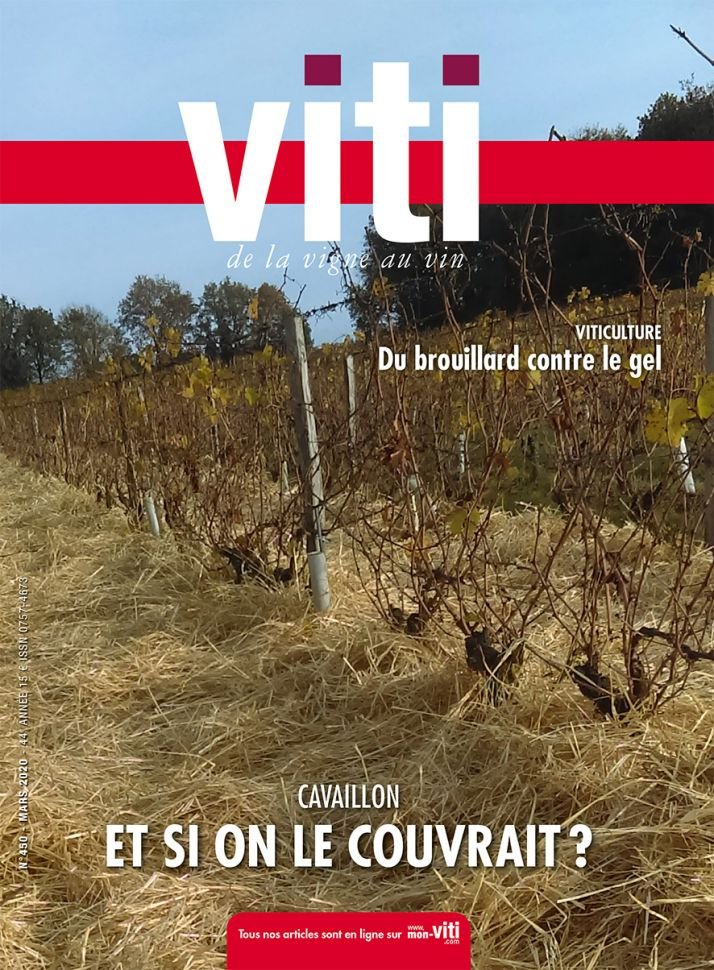L’Europe vient d’autoriser un nouvel auxiliaire technologique : les fibres végétales sélectives, capables de fixer les substances actives afin d’éliminer les résidus des produits phytosanitaires dans les vins.
De plus en plus de consommateurs s’inquiètent des résidus de produits phytosanitaires dans les vins, perçus comme des substances dangereuses pour la santé et pour l’environnement. Dans le même temps, l’évolution des techniques analytiques permet de détecter les molécules à des quantités de plus en plus faibles. Face à la pression du marché, les producteurs essaient de limiter, si ce n’est d’éliminer, les résidus des produits phytosanitaires utilisés en vigne et retrouvés dans les vins. C’est dans cette logique que l’application des fibres végétales sélectives en œnologie a été autorisée par l’Europe le 7 décembre 2019. Cette poudre brune, dont le concept a été développé par l’Institut français de la vigne et du vin (IFV) et aujourd’hui commercialisé par la société Laffort, présente la capacité de fixer certains résidus de produits phytosanitaires dans les vins.
« Nous avons travaillé sur l’origine des fibres végétales. Celles qui ont été autorisées proviennent des céréales et ne présentent aucun allergène », explique Valérie Lempereur, directrice adjointe des programmes scientifiques et techniques à l’IFV, et impliquée dans les deux projets de recherche européens sur les fibres végétales sélectives.
Sélectivité

Auxiliaire technologique de filtration
La conclusion est quelque peu mitigée : les fibres ne captent pas ou peu certaines matières actives, alors qu’elles vont bien en recueillir d’autres. « Malheureusement, nous n’avons pas d’explications au niveau chimique de cette variabilité », explique-t-elle.
L’Organisation internationale de la vigne et du vin a autorisé l’utilisation des fibres végétales sélectives en œnologie en juin 2017, en tant qu’auxiliaire technologique de filtration. « C’est la seule pratique autorisée à ce jour », précise la directrice adjointe. Plusieurs types de filtres ont été validés : filtre à presse, à plaque ou à alluvionnage peuvent s’utiliser avec la poudre biosourcée.
L’IFV a démontré que treize substances actives présentaient un taux de diminution supérieur à 50 % grâce à une filtration avec des fibres végétales sélectives : azoxystrobine ; boscalid ; benalaxyl ; cyprodinil ; fludioxonil ; fluopicolide ; iprodione ; mandipropamid ; metrafenone ; myclobutanil ; pyrimethanil ; spiroxamine ; tebufenozide.
Source : « Efficacité des fibres végétales sélectives à réduire la teneur en résidus de PP selon la matière active », « Revue des œnologues » n° 165, novembre 2017.
« Nous avons réalisé des analyses avant filtration, après, et sur le gâteau de filtration. Parfois, certaines molécules non présentes dans le vin d’origine se sont retrouvées dans le gâteau : elles n’étaient pas en concentration suffisante dans le vin pour être détectées, mais les fibres végétales sélectives ont exercé un effet de fixation et d’accumulation au niveau du rétentat. C’est un résultat très prometteur qui signifie que, même en petites quantités, les substances actives sont captées », constate Valérie Lempereur.
Bonnes pratiques d’utilisation
Aujourd’hui, seule la société Laffort commercialise des fibres végétales sélectives, sous le nom commercial Flowpure®. Sami Yammine, responsable de la gamme collage et stabilisation de l’entreprise, recommande de déposer la poudre de fibres végétales après la première couche de kieselguhr, à une dose maximale de 1,5 kg/m2 de la dose de la surface filtrante, puis de terminer en déposant une nouvelle couche de kieselguhr. Pour une bonne efficacité, tout le vin doit être au contact des fibres. C’est la raison pour laquelle ces dernières ont été micronisées : « En diminuant la taille des particules, nous avons pu augmenter la surface d’échange avec le vin, et, de fait, le captage, témoigne Valérie Lempereur. En outre, il n’y a pas besoin d’attendre un temps de contact important pour que ce soit efficace. »
Les fibres végétales sélectives sont performantes pour certaines molécules, moins pour d’autres. Ce qui laisse une incertitude pour l’opérateur quant à l’efficience de l’auxiliaire technologique. « Il y a une diminution, mais il n’y a aucune garantie sur le fait que le vin final n’aura plus de résidus détectables », prévient Valérie Lempereur. Elle remarque malgré tout « qu’il n’existe, à ce jour, aucune alternative parmi les solutions curatives ». Le charbon fonctionne mais avec des inconvénients majeurs sur le profil des vins. À l’inverse, les fibres végétales sélectives n’affectent pas les caractéristiques organoleptiques du produit. « C’est une technique complémentaire avec les bonnes pratiques d’utilisation des phyto en vigne », conclut-elle.
Il semblerait que la tendance générale soit à la réduction des résidus phytosanitaires dans les vins. Partagez-vous ce constat ?
Magali Grinbaum, responsable projets contaminants à l'IFV : Oui, si l’on compare les données actuelles à celles publiées dans les années 2000 et 2010, on constate que les concentrations en résidus retrouvés dans les vins sont en très forte diminution par rapport aux dernières décennies.
Quelles sont les molécules les plus fréquemment détectées dans les vins ?

L’origine des phtalimides et des acides phosphoreux fait débat. Ces molécules pourraient provenir d’une autre source que le produit phytosanitaire dont il est le marqueur. Or, lorsqu’elles sont détectées en analyse, il est impossible de connaître la cause de leur présence.
Serait-il possible de statuer sur l’origine phytosanitaire de ces molécules ?
M. G. : Nous travaillons actuellement à la définition de valeurs « de minimis » pour les résidus de produits phytosanitaires dans les vins, c’est-à-dire une valeur analytique en dessous de laquelle une substance est considérée comme absente du produit analysé. Les vins dont les résultats sont en dessous de ces « minimis » seraient considérés sans résidus.
Existe-t-il des techniques et/ou des outils qui permettraient d’éliminer les résidus phytosanitaires dans les vins, comme les fibres végétales sélectives ?
M. G. : Pour les fibres végétales sélectives, les résultats sont très significatifs et plutôt efficaces mais ils sont « molécules-dépendants ». C’est-à-dire que certaines molécules sont éliminées totalement, d’autres ne sont que diminuées et, enfin, certaines ne sont pas ou peu impactées.
Article paru dans Viti 450 d