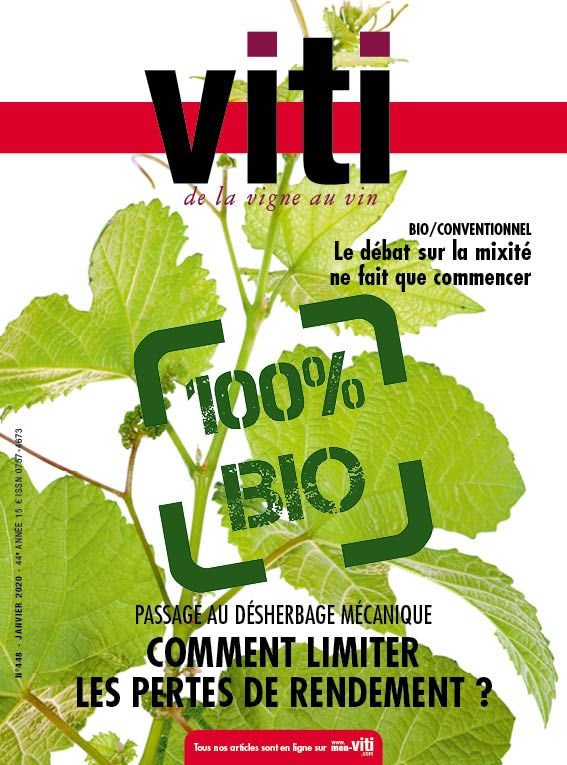Passer au désherbage mécanique du cavaillon peut engendrer une baisse de rendement, mais ce n’est pas une fatalité. Créer une zone de travail permet notamment d’éviter les perturbations au niveau du système racinaire de la vigne.
Lors du passage en viticulture biologique, l’une des étapes les plus délicates qui freine certains producteurs est la gestion de l’herbe, et plus spécifiquement le passage au désherbage mécanique du cavaillon.
Une baisse de rendement est souvent notée lors du passage à l’entretien mécanique du rang, mais elle n’est pas systématique.

Constituer une zone de travail au-dessus de la ligne du sol
Pour éviter de trop couper les racines de la vigne, l’idéal est de constituer une petite zone de travail au-dessus de la ligne du sol : une petite butte. « Elle peut être formée avec une charrue à vigne ou simplement par le passage de disques crénelés ou émotteurs qui projettent la terre, idéalement en combiné pour effectuer en seul passage : désherbage mécanique et reformation de la butte », indique Arnaud Furet, conseiller viticole d’Adabio. « Si on utilise une décavaillonneuse sur un sol à plat, on cherche la profondeur, si on l’emploie sur une butte, on ne travaille que la butte. Mais ce n’est possible que si le viticulteur ne se fait pas déborder par les adventices et effectue bien les passages au stade plantule. Dans ces conditions, l’impact sur les racines de la vigne est limité et les pertes de rendement ne sont pas automatiques », estime Christophe Gaviglio.
Pour éviter la baisse de rendement lors du passage au désherbage mécanique du cavaillon, quelques précautions sont à prendre : tout d’abord, il est préférable de ne pas travailler trop profondément et donc de régler son outil en conséquence (2 à 4 cm de profondeur suffisent) pour ne pas abîmer les racines superficielles. Il est recommandé de ne pas passer l’interceps simultanément des deux côtés des rangs de vignes. L’idéal est de pratiquer, pendant un ou deux ans, un désherbage mixte, mécanique/chimique pour une transition en douceur : sur un demi-rang on travaille le sol et désherbage chimique/tonte sur l’autre demi-rang. Ensuite, pour la troisième année, il est possible de commencer le travail mécanique sur le demi-rang jusque-là désherbé. Cette introduction progressive du travail du sol sous le rang génère ainsi moins de stress, avec moins de racines coupées d’un seul coup, et la vigne a ainsi le temps de s’adapter, « d’encaisser ».
Selon le type de parcelle (historique des vignes, âges, type de sol, sol bien ressuyé ou non) et les outils utilisés, le passage au désherbage mécanique peut être effectué plus ou moins rapidement.
« Sur des vignes désherbées depuis plusieurs années chimiquement avec des résiduaires, il n’y aura pas beaucoup d’évolution de flore pendant trois ans. Si les racines ne sont pas très superficielles, le passage au désherbage mécanique peut être fait immédiatement en totalité. Sur des vignes sur sols superficiels, avec beaucoup de racines de vigne en surface, le risque est évidemment plus élevé. D’où l’intérêt de constituer une petite butte au-dessus de la ligne de sol », précise Christophe Gaviglio.
« Tout dépend du point de départ », confirme Arnaud Furet. L’âge des vignes, souvent considéré comme un frein sur les vignes les plus anciennes, n’est pas forcément un problème. Sur des vignes âgées, il est conseillé de réaliser au préalable une petite fosse pour observer le système racinaire. Il faut également être progressif dans l’utilisation des outils : venir directement avec des outils rotatifs entre les ceps, c’est agressif, alors que travailler une petite butte juste avec des doigts Kress ou des disques n’a pas cet inconvénient. Il ne faut pas hésiter à combiner les outils dans la saison. »

Le projet, commencé en 2014 et conduit sur plusieurs années, a montré une perte de rendement variable selon les millésimes, entre la modalité de désherbage mécanique du cavaillon et le désherbage chimique du cavaillon (conduite classique). Les baisses de productivité de la vigne notées sur les premières années (- 9 % en 2014, - 46 % en 2015) ont été en majorité imputées à l’alimentation azotée de la vigne. En mai 2016, une fertilisation (farine de soie de porc à 14 % d’azote) a été réalisée sur la modalité pied à pied, ainsi qu’en janvier 2017 (compost, avec rapport C/N intermédiaire). Les rendements ont baissé de 32 % en 2016, mais ont augmenté de 2 % en 2017.
Article paru dans Viti 448 de janvier 2020