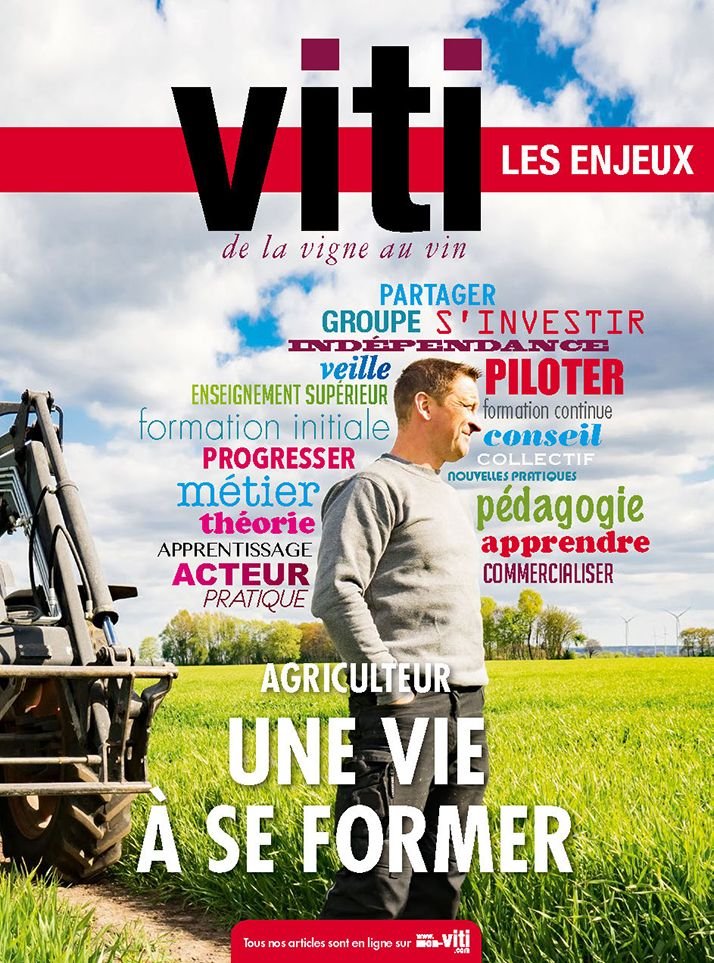Chaque année, les vignerons français tirent quelque 1,6 million de tonnes de bois de taille1. Broyés et laissés dans les parcelles, ils constituent une source de carbone intéressante pour la vie et la structure du sol.
Deux tonnes par hectare. C’est en moyenne la quantité de bois taillé chaque année dans les vignes. S’ils peuvent être valorisés en dehors de la parcelle, les sarments ont avant tout un intérêt agronomique, lorsqu’ils sont restitués au sol. « Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les bois ne sont pas essentiellement constitués de lignine mais de cellulose et d’hémicellulose, introduit Xavier Salducci, spécialiste du sol et directeur du laboratoire d’analyses biochimiques Celesta-Lab (Hérault). Ce point est intéressant lorsque l’on sait que ces deux macromolécules sont facilement dégradables. Elles vont servir de "nourriture" à des sols viticoles qui, bien souvent, manquent de matières organiques actives. Dans l’année, 60 % de la matière constituant les bois de taille vont être minéralisés et consommés par les organismes du sol. Le reste va se transformer en humus, stocké dans le sol. Plus le sol est vivant, plus la dégradation des sarments sera rapide, car un sol riche en organismes divers consomme de la matière organique. »
Selon Xavier Salducci, les 2 tonnes de sarments restitués seraient même un minimum pour entretenir la vie du sol, surtout lorsque la parcelle n’est pas enherbée. « Et même sur une parcelle qui présente un enherbement permanent et poussant, je ne conseille pas d’exporter les bois de taille. Car si le couvert apporte de la matière organique facilement dégradable, il n’a qu’un faible impact sur le stockage d’humus. Laisser les bois de taille au sol tous les ans est une stratégie gagnante quelle que soit la situation. »
Du brûlage au broyage
Ces arguments agronomiques, complétés par une réglementation de plus en plus restrictive, portent dans des régions où traditionnellement les bois de taille sont brûlés. En Bourgogne, Fabrice Dulor, directeur commercial de Boisselet, société basée en Côte-d’Or et constructeur de broyeurs le constate. « Les ventes de broyeurs hors-sol pour vigne étroite sont en augmentation dans la région. Des domaines qui auparavant brûlaient les bois, s’équipent. »

MALADIES DU BOIS. D’après Florence Fontaine (Université de Reims) et Philippe Larignon (IFV), experts dans les maladies du bois, il n’y a pas de contre-indications à laisser les sarments broyés dans les vignes atteintes d’esca, d’eutypiose, de BDA. Bien que les études manquent pour savoir si la contamination par le sol est significative dans le développement des maladies du bois, il est avéré que les sarments de l’année sont faiblement porteurs de spores pathogènes.
Même constat dans le Beaujolais. Sur les sols sableux acides de ce vignoble, la transition vers le broyage n’est pourtant pas des plus simples. « Naturellement, ces types de sol n’ont pas une activité biologique importante. La biodégradation des bois peut être mauvaise surtout sur des sols nus. Chaque situation est à traiter individuellement, mais il vaut mieux commencer par enherber la vigne, conseille Xavier Salducci. Cette pratique restaure plus rapidement une vie dans le sol. Par la suite, on peut envisager de laisser les bois de taille. »
Rémy Passot, vigneron sur le cru Chiroubles (69) a adopté cet itinéraire. « Il y a 7 ans, notre tracteur enjambeur avait besoin d’être changé. Cela a été l’occasion de repenser la façon d’entretenir les 11 ha du domaine plantés à 10 000 pieds/ha sur des pentes allant jusqu’à 20-30 %. Plutôt que de renouveler l’enjambeur, nous avons acheté un tracteur interligne. Pour circuler avec dans les vignes étroites, un rang sur 6 a été arraché. Un enherbement permanent a été aussi mis en place. Un an plus tard, nous avons commencé à broyer les sarments. Dans les 5 rangs non accessibles, nous transportons à la main les bois de taille dans le rang broyable. La vigne est en gobelet non palissée ; donc il est facile d’aller d’un rang à l’autre. En février-mars, le broyeur hors-sol sert également de faucheuse. Aujourd’hui, je m’interroge sur la pertinence d’un couvert permanent, en revanche, je ne remets pas en question le broyage des sarments. »
(1) Considérant que la surface de vigne en production en France est de 793 900 ha et que la production moyenne de bois est de 2 t/ha.
« Nous sommes passés au broyage »

Article paru dans Viti hors-série Les Enjeux de décembre 2017